
Château de Beynac
Châteaux - Palais - Manoirs
Réalisation : 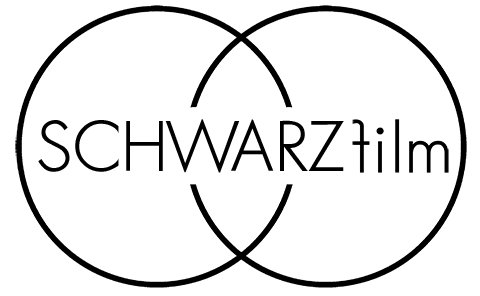 © 2020
© 2020


Réalisation : 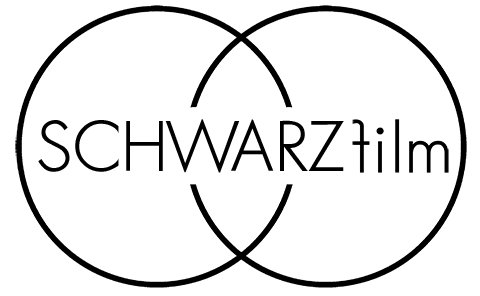 © 2020
© 2020
Les lourds murs de défense étaient autrefois gardés par quelques-uns des personnages les plus célèbres de France : le roi Richard Ier "Cœur de Lion" d'Angleterre, que nous avons déjà croisé en tant que prisonnier au château du Trifels, Simon de Montfort, chef de l'une des croisades, les seigneurs de Beynac et les quatre seigneurs du Périgord, qui régnaient dans la salle d'apparat du château. On dit qu'au cœur de la forteresse, l'écho des batailles de la guerre de Cent Ans résonnerait encore.

La maçonnerie en pierre de taille à bossage du 12ème siècle est typique des Staufer sur les parties conservées d'origine. Le donjon le plus haut et le mieux conservé du Palatinat vaut particulièrement le coup d'œil. De sa plate-forme de 23 mètres de haut, on a une vue étendue sur la plaine du Rhin. C'était d'ailleurs nécessaire, car le château devait avant tout protéger l'abbaye bénédictine de Klingenmünster toute proche. À l'intérieur, un musée avec des objets trouvés et des panneaux d'affichage informe clairement sur la vie au château. Le chemin qui mène au chenil en passant par le fossé extérieur de 11 mètres de profondeur est également impressionnant, car il permettait de tirer sur les ennemis qui s'étaient infiltrés depuis le mur intérieur du château. Les murs d'enceinte extérieurs du Zwinger ont été construits aux 14e et 15e siècles, après l'invention des armes à feu de plus grande portée.

Avec les pluies d'automne et de printemps, la Dordogne devient navigable. Elle est la voie la plus sûre entre Bergerac et le Bordelais. Le long de son cours méandreux, des bateaux à très faible tirant d'eau, les gabarres, transportent des marchandises comme les noix, les châtaignes, le bois ou le vin du Périgord. Chaque bateau doit acquérir un droit de passage auprès du seigneur de Beynac.
Dès le 13ème siècle, la pêche seigneuriale, réputée pour son saumon, s'est installée le long de la rivière, en aval du château. La position stratégique de la forteresse de Beynac lui permettait de contrôler facilement les cours d'eau locaux, ce qui augmentait considérablement son pouvoir économique et faisait de son seigneur l'une des figures les plus puissantes des 12e et 13e siècles.
Adhémar de Beynac mourut en 1194. Ne laissant aucun héritier direct, il permit à Richard Ier, à juste titre, d'offrir le château de Beynac à l'un de ses plus fidèles compagnons, un homme auquel il confia également la responsabilité de ses châteaux en Aquitaine pendant son absence : le guerrier Mercadier.

Les cuisines ont été installées au cours des rénovations du 13e siècle et ont radicalement changé l'aspect du château. Comme les seigneurs de Beynac pouvaient s'offrir une telle cuisine, ils montraient une fois de plus leur puissance et leur richesse.
Les crochets fixés au plafond permettent de garder les provisions hors de portée des rats. Le sol en pisé forme ici un chemin à travers la roche contre laquelle sont construites les cuisines des châteaux. La cuisine, conçue dans des dimensions normalement réservées aux châteaux et aux abbayes, permettait de rôtir la viande, tout en disposant également d'un four à pain, élément essentiel pour tous les repas.
Même si les seigneurs de Beynac ne sont plus là, la puissance qui émanait autrefois de ce lieu est perceptible et impressionnante à chaque pas.